Samedi 06 Septembre 2025
Alors que Starfish Neurosciences vient de dévoiler son plan de développement, notamment en s'engageant à réduire l'aspect invasif de son futur appareil et à favoriser l'implantation d'interfaces dans diverses zones du cerveau, les interfaces cerveau-machine (ICM), longtemps cantonnées aux laboratoires ou aux fictions, pourraient bien s'intégrer durablement à notre quotidien.
Cependant, cette innovation, loin de se limiter à une nouvelle prouesse technologique, représente un véritable tournant dans notre relation au corps, à la pensée, et à l'être humain lui-même.
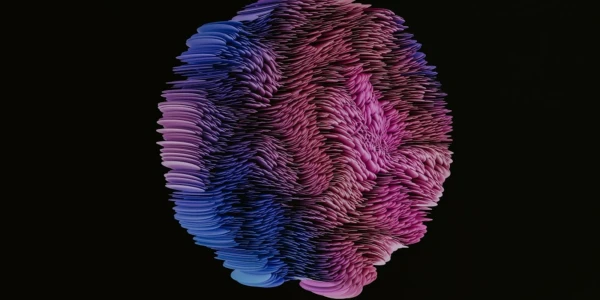
Depuis son origine, l'Homme n'a eu de cesse de créer des outils pour pallier ses faiblesses et dépasser ses limites. Les ICM incarnent d'une certaine manière l'aboutissement de cette démarche : elles ne se contentent plus de prolonger nos membres, comme le fait un smartphone, mais s'insèrent désormais au cœur de notre cognition. Le philosophe Marshall McLuhan décrivait la technologie comme un prolongement du corps ; les ICM s'apparentent davantage à un prolongement de l'esprit.
Néanmoins, une question cruciale se pose : jusqu'où pouvons-nous hybrider l'humain sans en altérer son essence même ? À l'image du cyborg imaginé par Donna Haraway, ces nouvelles interfaces remodèlent les frontières entre nature et technologie, liberté et dépendance, identité et algorithme. Une mutation est en cours, à la fois fascinante, préoccupante et profondément philosophique.
Concrètement, de quoi parlons-nous ?
Définies par l'Inserm comme un système de connexion directe entre un cerveau et un ordinateur, les ICM permettent à un individu d'accomplir des tâches sans faire appel aux nerfs périphériques ni aux muscles. Grâce à la mesure de l'activité cérébrale et à sa transformation en actions concrètes, elles offrent notamment aux personnes souffrant de handicaps sévères la possibilité de retrouver une certaine autonomie. Par le biais d'un dispositif, implanté dans le cerveau ou d'un capteur externe, une personne amputée peut ainsi contrôler les mouvements d'une prothèse par la seule force de la pensée. Des individus atteints de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, sont aujourd'hui capables de "communiquer" en traduisant leurs signaux cérébraux en paroles avec une précision toujours croissante.
Les ICM, et leurs fonctions d'acquisition, de traitement et d'activation du signal, laissent entrevoir de véritables exploits dans certains secteurs. Leurs applications principales, qu'elles soient existantes ou émergentes, se situent principalement dans les domaines de la santé, notamment en matière de soins, de la défense et des jeux vidéo. Bien que leur adoption en entreprise reste marginale, notamment en raison de leurs coûts élevés, leur potentiel est indéniable. Elles pourraient, à terme, amplifier les compétences et favoriser l'amélioration des niveaux de performance des équipes opérationnelles.
Afin de capitaliser sur le potentiel des ICM, le marché devra se structurer rapidement. Les progrès technologiques demeurent inégaux selon les composantes d'une interface, en particulier au niveau des capteurs, qui constituent l'élément central du dispositif. Mais le développement des interfaces cerveau-machine suit des voies différentes selon les secteurs, tout comme la promesse des révolutions associées.
Actuellement, l'innovation dans le domaine médical est principalement portée par des plateformes open source et des start-ups (Neuralink, Synchron, Blackrock Neurotech, Precision Neuroscience, Starfish Neurosciences, etc.) qui bénéficient du soutien financier des États, d'investisseurs privés et d'agences gouvernementales telles que la DARPA aux États-Unis, tandis que l'industrie du jeu vidéo progresse de manière indépendante.
Quelles perspectives ?
La technologie des interfaces cerveau-machine a le potentiel d'être très disruptive à bien des égards, avec une possible adoption généralisée dans les 10 à 15 prochaines années, notamment dans certains secteurs déjà moteurs, comme la santé, où elle aura un impact social inévitable.
Pour s'imposer dans le monde des entreprises, le développement des ICM dépendra de plusieurs facteurs clés, tels que les avancées techniques, la conception des systèmes, l'attrait du marché et surtout leur accessibilité. La trajectoire de ces systèmes sera également tributaire de facteurs tiers, tels que le débit (c'est-à-dire la rapidité et l'efficacité de la traduction des signaux cérébraux en résultats significatifs), l'utilité (c'est-à-dire la gamme d'applications utiles au-delà des niches actuelles) et la réglementation.
Mais la diffusion des ICM dépendra en grande partie de l'évolution de notre société en termes d'acceptabilité et de politiques. Elles sont réelles, puissantes et riches de potentiel, mais leur évolution est loin d'être simple. À mesure que la technologie progresse, les questions essentielles ne seront plus seulement scientifiques, mais aussi éthiques, économiques et sociétales. Face à elles, il nous faudra déterminer ce qui relève du possible et ce qui est souhaitable. Sommes-nous prêts à y faire face davantage ?
Par Albert Meige, Associé et Global Director du Blue Shift institute - Arthur D. Little




