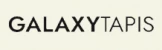Mardi 22 Avril 2025
OpenAI a dévoilé une récente amélioration significative pour ChatGPT : son modèle de conversation phare est maintenant capable de s'appuyer sur l'ensemble des échanges antérieurs d'un utilisateur pour générer des réponses plus personnalisées et adaptées au contexte. Cette aptitude, initialement réservée aux adhérents Plus et Pro situés hors d'Europe, représente une étape importante dans la transformation de ChatGPT, le faisant évoluer d'un simple outil ponctuel à un assistant capable de s'adapter.
D'une mémoire auparavant fragmentée à une rétention globale.
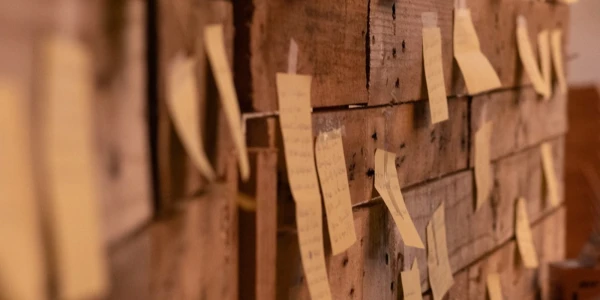
Jusqu'à maintenant, la capacité de mémorisation de ChatGPT se limitait à une session spécifique ou à des informations éparses sur les préférences enregistrées (style, sujets récurrents). Grâce à cette nouvelle fonction, l'IA peut désormais accéder à tout l'historique des conversations, ouvrant ainsi la voie à une personnalisation plus poussée, une continuité dans le déroulement des projets et la possibilité d'établir des liens sur le long terme.
La promesse est ambitieuse. Dans un cadre professionnel, un assistant doté d'une mémoire étendue pourrait non seulement prendre en compte les défis stratégiques habituels d'un utilisateur, mais également suivre son calendrier de publication, adapter ses réponses en fonction de ses arguments préférés et tenir compte de ses interlocuteurs réguliers. Pour un usage personnel, cela garantit une continuité : projets en cours, préférences de style, objectifs à long terme. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un gain d'efficacité et d'une plus grande fluidité.
Cependant, cette mémoire accrue soulève des interrogations. Pourrait-elle conduire à un assistant trop prévisible ? En s'adaptant aux habitudes de l'utilisateur, ne risque-t-elle pas de rigidifier la variété des perspectives et de renforcer les préjugés cognitifs ?
Enjeux éthiques et contrôle des données.
Cette connaissance approfondie du comportement de l'utilisateur soulève également des questions d'ordre éthique. OpenAI permet aux utilisateurs de conserver un contrôle total sur cette fonctionnalité : ils ont la possibilité de consulter, modifier ou effacer les souvenirs enregistrés, voire de désactiver complètement la mémoire. Malgré cette capacité de gestion, quel est le niveau de transparence concernant les données utilisées ? En raison des réglementations européennes, notamment le RGPD, cette mémoire à long terme n'est d'ailleurs pas accessible au sein de l'UE.
Un écosystème en mutation.
ChatGPT n'est pas le seul modèle à explorer la mémoire longue. Plusieurs acteurs développent également des IA capables de contextualisation étendue :
Claude (Anthropic) propose une mémoire de type RAG (Retrieval Augmented Generation), qui combine conversation et bases de connaissances externes, en mettant l'accent sur l'éthique et l'alignement avec l'utilisateur ;
Gemini (Google DeepMind) intègre des éléments de contextualisation transversale au sein de l'écosystème Google Workspace, préfigurant une forme de mémoire distribuée mais axée sur les usages documentaires ;
Meta travaille sur des assistants sociaux dotés d'une mémoire relationnelle, intégrés aux plateformes sociales, où la continuité affective est privilégiée par rapport à l'analyse rationnelle ;
Des projets comme Pi (Inflection AI) ou Character.AI misent sur une mémoire émotionnelle, dans le but de construire une relation suivie et engageante avec l'utilisateur.
La convergence vers une mémoire longue semble inévitable, mais les approches divergent : efficacité professionnelle, fidélisation émotionnelle ou intégration écosystémique. À terme, le véritable défi ne sera peut-être pas la capacité à se souvenir, mais la capacité à choisir ce qu'il est nécessaire d'oublier.
Vers un nouvel équilibre.
Cette mémoire amplifiée marque peut-être le début d'une nouvelle relation avec les assistants conversationnels. Il reste à déterminer si l'utilisateur est prêt à accepter ce niveau "d'intimité technologique", et à quels compromis il est disposé à consentir en matière de personnalisation, de diversité et de vie privée.